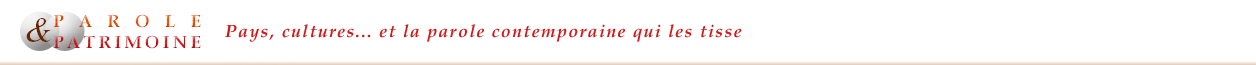Un petit livre encore, simple à lire et qui brosse par petites touches une crise de plus, celle d’un monde où les récits s’étiolent et où donc notre rapport aux autres et au vivant perd de sa substance.
Byung-Chul Han est originaire de Corée du Sud, où il commença des études de métallurgie, avant de se pencher sur la philosophie et la théologie, en Allemagne. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, publiés en français aux PUF et chez Actes Sud, ouvrages tous à l’écriture fluide.
Celui-ci1 s’intéresse aux histoires que les hommes se racontent depuis bien longtemps et qui les ont fondés en quelque sorte, si l’on pense aux mythes des sociétés traditionnelles que l’on se transmettait de génération en génération, puis aux premiers récits écrits (l’épopée de Gilgamesh, les récits bibliques, le Coran…), et enfin aux récits que de multiples écrivains, depuis l’invention de l’imprimerie, ont tissés dans la mémoire commune. Petit parcours dans l’ouvrage, qui dévoile une rupture de plus, ou même une lézarde dans l’imaginaire.
Ce que pointe d’abord le philosophe est que le récit n’est pas de même nature que l’information. Le lecteur de journaux passe d’une nouveauté à une autre, son regard est rapide, bondissant, même s’il ne zappe pas constamment.
La nouvelle que contient une histoire présente toujours une autre structure spatiale et temporelle que l’information. Elle vient “ de loin ”. Le lointain est son trait essentiel. Le démantèlement progressif du lointain est une caractéristique de la modernité. → p. 18
L’information, elle, ne contient pas de distance, elle ne “ survit pas à l’instant de sa prise de connaissance ”. Et son inflation actuelle en limite encore plus la portée temporelle, les infos se détruisent elles-mêmes dans leur rapide succession. Byung-Chul Han cite Walter Benjamin :
Le conteur tire ce qu’il raconte de l’expérience, de la sienne propre et de celle qui lui a été racontée. Et il en fait à nouveau une expérience pour ceux qui écoutent ses histoires. → p. 23
Et la numérisation, là encore, rebat les cartes, elle réduit le réel :
L’informatisation de la réalité fait que l’expérience immédiate de la présence s’étiole. → p. 26
Le développement de l’information devient une forme de domination à laquelle nous sommes tous désormais confrontés.
Les informations morcellent le temps. Le temps se raccourcit pour ne plus être qu’une fine trace de l’actuel. […] Le passé n’exerce plus d’action sur le présent. Le futur se resserre jusqu’à ne plus être qu’un update permanent de l’actuel. […] La vie qui avance en suspension d’un présent à l’autre, d’une crise à l’autre, d’un problème à l’autre, se fige à l’état de survie. → p.38
Les plateformes numériques brisent l’imaginaire du récit, elles le dissolvent :
Les états et les humeurs sont régulièrement enregistrés. On tient un procès-verbal rigoureux de l’ensemble des activités du quotidien. […] Ce faisant, on ne raconte rien : on ne fait que mesurer. […] Seul le récit nous aide à nous connaître nous-mêmes : il faut que je me raconte. Mais les comptes, eux, ne racontent rien. → p. 50-51
“ Raconter exige de l’oisiveté. ” À l’instar du poète Christian Bobin qui faisait lui aussi l’éloge de la lenteur sinon de la paresse, le philosophe prend des exemples et montre comment la recherche de sens dans le récit se fait dans la tension narrative, pas à pas, en tissant des liens dans l’imaginaire, en construisant peu à peu ce qu’on peut nommer la présence, ou l’aura :
L’aura est l’éclat qui élève le monde au-dessus de sa pure facticité, le voile mystérieux qui se dépose autour des choses. → p. 72
La narration est un jeu d’ombre et de lumière, de visible et d’invisible, de proximité et de lointain. → p.76
À l’inverse, la volonté de transparence absolue brise l’enchantement, elle décompose le monde “ en données et en informations ”.
Il n’existe pas de récit transparent. Tout récit suppose mystère et enchantement. → p. 77
Dans un des derniers chapitres, l’auteur cite Chris Anderson, rédacteur en chef du magazine branché américain Wired, qui annonce la fin des théories :
C’en est fini de toute théorie du comportement humain, de la linguistique à la sociologie. […] Qui peut bien dire pourquoi les gens font ce qu’ils font ? Ils le font, tout simplement, et nous pouvons le suivre et le mesurer avec une précision sans précédent. Quand il y a suffisamment de données, les nombres parlent d’eux-mêmes. → p. 92
Devant cette sorte de démission de l’humain devant la technologie, Byung-Chul Han défend la théorie comme récit, et rétorque :
La théorie comme récit dessine un ordre des choses qui met celles-ci en relation et explique, de la sorte, pourquoi elles se comportent ainsi les unes avec les autres. Elle développe des liens conceptuels qui rendent les choses compréhensibles. Contrairement au Big Data, elle nous offre la forme suprême du savoir, c’est-à-dire la compréhension. […] La fin de la théorie signifie au bout du compte les adieux au concept comme esprit. L’intelligence artificielle n’a aucun besoin de concept. L’intelligence n’est pas l’esprit. Seul l’esprit est capable de produire un nouvel ordre des choses, de produire un nouveau récit. → p. 92-93
1 Byung-Chul Han, La crise dans le récit, PUF, 2025.
Écriture le 21/06/25