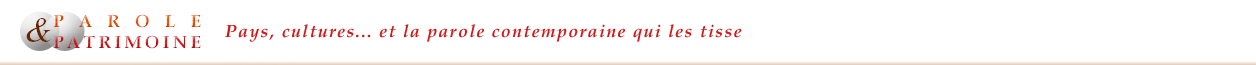Cette sensation d’abord peut-être d’une présence qui nimbe les jours, celle des visages bien sûr, mais aussi des lieux, des paysages d’humanité. Et que cette présence se nourrit d’une mémoire grande, celle des lointains de l’espace et du temps, celle des traces précaires, les œuvres, les images…
Quelques dizaines de kilomètres depuis Paksé, la grande ville du sud Laos. On longe longtemps le Mékong, le fleuve vital, l’artère vivifiante de cette région de l’Asie.
La pluie fait un refuge, elle maintient les distances,
la pluie protège
Les mouvements des hommes
depuis si longtemps
qui s’échangent ce qu’ils font, ce qu’ils disent
Quand on pénètre dans la salle du Museo Civico où se trouve cette fresque, c’est une sorte de stupeur dans le corps d’abord.
C’est un livre qui tient du roman, du récit, de l’enquête, un livre intime et pourtant au cœur du monde, un livre peut-être comme une trace fulgurante à ce moment de notre aventure humaine, et dont on se demande s’il peut être reçu, comme on dit, accepté quelque peu, tant il est à sa manière iconoclaste.
Nous nous tenons par la main
par le regard
par le chatoiement des visages
par la ténuité du vivant partagée sur le monde.
Tu marches près de moi
l’ombre de nos silhouettes va grandissante
L’impression, maintenant, que tout peut arriver, que le monde est comme en suspens, proche d’un point de bascule, peut-être même d’une rupture irréversible où les nations vont s’engouffrer.
D’où j’écris, l’horizon laisse voir la lumière
à travers les collines et les rideaux de pluie
bientôt le printemps et la nature en amour
qui va reprendre le cycle des vies précaires et tenaces.
C’est un édifice très ancien blessé par le feu et qu’on a reconstruit par des milliers de mains, pour en révéler de nouveau la grandeur.
C’est dans une petite salle de l’hiver, tout près d’une autre où elle repose, cette amie qui vient de s’en aller de la vie.
C’est un jour où la lumière
se pose sur la vie
Il crachine ce matin-là sur la Loire, le vent d’océan fait germer les rides d’eau sur la surface du fleuve.
Certains lieux sont plus vivants que d’autres, les lieux sont un peu comme les humains, variés, exprimant avec plus ou moins d’intensité le génie justement des humains qui les ont fait naître.
Peur des douleurs, peur de la mort
peur des jours amenuisés qui s’en viennent
peur banale de l’âge
Nous sommes partis de Parapat, quelques kilomètres sur un bateau bien chargé, et l’on arrive à Samosir, l’île au milieu de cet immense cratère volcanique devenu ce lac Toba, de cent kilomètres de long, berceau de la culture des Toba-Batak.
C’est la lumière de l’hiver encore, juste diaphane, qui hésite entre le brouillard et le soleil, entre le songe et le réel.
C’est autrefois, il y a bien un quart de siècle, et c’est tout près pourtant. C’est le matin très tôt, il fait très doux dans le premier soleil.
Pluie d’hiver, tout le jour. La pluie fait le gris sur le monde, je vois au loin le rideau d’arbres qu’elle efface presque.
La lumière de l’hiver
comme une révélation
La ville est proche de l’Adriatique, on va vers elle dans le plat de la terre. Et l’on se dit que le site était indéfendable. Et l’on se demande comment elle a pu devenir la capitale byzantine de l’Occident.
Dehors, les enfants jouent
parmi les fleurs et la lumière d’avant-printemps,
et leurs visages donnent de la lumière au monde,
C’est à l’hôpital, dans le dédale des couloirs, au travers des portes qu’on pousse, l’hôpital, c’est un univers étalé, anonyme, aux repères flous.
C’est l’automne. Dans cette terre à l’écart
des villages de Saintonge,
C’est un cyclone qui passe sur une île et qui dévaste tout ce que les hommes ont bâti là, c’est une voiture qui fonce dans la foule et fait grandir la mort sur son passage
Terminons notre parcours des visages byzantins par des vues de Géorgie, qui vont du XIVe au XVIIe siècles.
Ce quatrième périple dans les visages byzantins est entièrement consacré à des images du XIVe siècle, et principalement à des vues en provenance de Saint-Sauveur in Chora, à Istanbul.
Continuons notre parcours des visages, pour la période des XIe et XIIe siècles, sur les terres turques et géorgiennes, aussi bien dans des lieux retirés que dans des ensembles patrimoniaux plus importants.
Second parcours des visages et des icônes, dans la période du IXe au XIe siècles, en Géorgie, c’est-à-dire sur des terres orthodoxes, mais bien éloignées du centre byzantin qu’était Constantinople.